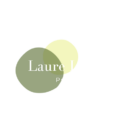1 - Introduction
Selon la conception traditionnelle qui prédominait à l’époque au sujet de la mémoire, les souvenirs passent, après un apprentissage, par une phase de consolidation. Cela a pour effet de les rendre stables et durables. Cette vision traditionnelle affirme qu’une fois consolidée, la mémoire est fixe et ne peut être modifiée sans un nouvel apprentissage.
L’étude pionnière de Nader, Schafe et LeDoux (2000) a remis en question cette idée., En utilisant un modèle animal et un protocole de conditionnement à la peur, les auteurs ont démontré qu’une réponse conditionnée de peur peut être modifiée drastiquement dans certaines conditions et sans entraînement comportemental. Cet article explore en détail cette étude, ses résultats, ses implications et ses limites.
2- Contexte
La consolidation de la mémoire est un processus au cours duquel un apprentissage ou souvenir initialement fragiles deviennent stables et pérennes. Les modèles classiques expliquent que cette étape dépend d’une synthèse protéique neuronale. Une fois consolidé, un souvenir ne devrait plus nécessiter cette synthèse protéique pour se maintenir.
Nader et al. (2000) ont testé cette hypothèse dans le contexte de la mémoire émotionnelle de peur chez l’animal.
Concept important pour comprendre l’étude :
Le protocole de conditionnement classique des réponses de peur chez l’animal consiste à présenter un stimulus initialement neutre (stimulus neutre, SN) immédiatement suivi d’un stimulus aversif (stimulus inconditionné, SI). On sait que le stimulus inconditionné (SI) évoque sans apprentissage préalable une réponse de stress chez l’animal. Ce peut être par exemple un choc électrique.
Après plusieurs associations SN-SI, le SN présenté seul acquière la propriété de déclencher une réponse de peur : il devient alors un Stimulus conditionné (SC).
L’une des régions cérébrales clés impliquées dans ce type d’apprentissage est l’amygdale, et plus particulièrement son noyau basolatéral (LBA). Cette structure joue un rôle central dans l’association entre le stimulus neutre et le stimulus aversif, en intégrant les informations sensorielles et émotionnelles pour produire une réponse conditionnée, telle que le freezing (réponse d’immobilité).
3- Méthodologie de l’étude
L’expérience repose sur un paradigme de conditionnement classique de la peur chez le rat.
Protocole général :
A. Apprentissage initial : association du SC (son) au SI (choc électrique)
B. Test 1 : 24 heures après, présentation du SC seul pour réactiver la mémoire de peur.
Manipulation expérimentale au cours de cette phase : injection d’un inhibiteur de la synthèse protéique directement dans le noyau basolatéral de l’amygdale, ou injection d’un placebo. Il est important de préciser que cet inhibiteur de synthèse protéique est connu pour empêcher la synthèse de protéines nécessaires à la mémorisation à long terme, ou autrement dit la consolidation d’un apprentissage.
C. Test 2 : 24 heures après, présentation à trois reprises du SC seul et Mesure du pourcentage de temps passé à être figé (« freezing »), indicateur comportemental de la mémoire de peur.
Manipulations complémentaires :
- Différentes doses d’inhibiteur protéinique
- Injection avec ou sans rappel du SC.
- Injection différée (6 heures après rappel).
- Intervalle entre apprentissage initial et rappel (24 heures vs 14 jours).
4- Résultats
Les principaux résultats observés sont :
- Au cours du test 1, les rats de tous les groupes s’engagent dans des comportements de freezing. Le stimulus conditionné évoque bien à lui seul les réponses de peur et l’apprentissage est intact à ce stade pour tous les groupes.
- Au cours du test 2 : Diminution significative du pourcentage de temps passé à figer pour la population de rats ayant reçu une injection d’inhibiteur de synthèse protéique, indiquant une dégradation de la mémoire de peur.
- Effet dose-dépendant : Le pourcentage moyen des réponses de figement est affecté par la quantité d’inhibiteur protéique injecté. Faible quantité : résultats similaires au groupe contrôle.
- Importance du rappel préalable : sans présentation du SC avant l’injection, l’inhibiteur n’a pas d’effet. Cela illustre que la présentation du déclencheur est nécessaire pour déclencher la reconsolidation.
- Fenêtre temporelle limitée : l’effet disparaît si l’injection intervient 6 heures après le rappel, suggérant que la reconsolidation se déroule dans une fenêtre temporelle spécifique.
- Effet du délai entre apprentissage et rappel : un rappel 14 jours après l’apprentissage initial montre une réduction du freezing, ce qui montre que la reconsolidation est possible même pour un apprentissage plus ancien.
5- Discussion
Ces résultats sont remarquables. Souvenons-nous que l’inhibiteur de synthèse protéique a pour effet connu de bloquer la mémorisation à long terme. Selon le modèle classique de la mémoire, on aurait donc pu s’attendre à ce que le groupe expérimental soit incapable d’apprendre que le SC n’est plus suivi du SI, et que les réponses de freezing restent importantes lorsqu’il est de nouveau confronté au son 24 heures plus tard. Or, c’est le contraire qui se produit : les réponses de freezing diminuent drastiquement.
Cela suggère qu’en bloquant le processus de synthèse protéique, la trace initiale est altérée. En d’autres termes, pour consolider un souvenir à l’identique, le cerveau doit être actif lors du rappel en synthétisant des protéines spécifiques. On peut ainsi envisager qu’à chaque réactivation de l’apprentissage, le cerveau réengramme la trace. Si ce processus est perturbé, la mémoire se dégrade.
6 - Remarques
Voici les limites que je perçois dans cette étude :
- Diminution de la réponse de freezing mais pas de suppression totale : les réponses de peur n’est jamais totalement éliminée, même après
inhibition de la synthèse protéique. . - Absence d’analyse comportementale complémentaire : seul le freezing est mesuré, laissant en suspens d’autres réponses
comportementales possibles (exploration, fuite?)
Pourquoi j’ai choisi de présenter cet article?
Il représente une des premières (si ce n’est la première) démonstration expérimentale chez l’animal que pour chaque rappel d’une information, d’un apprentissage stocké en mémoire, le cerveau doit activement retraiter l’information pour maintenir la stabilité du souvenir! Cette découverte est fascinante! On a longtemps imaginé la mémoire comme un livre immuable : on peut le rouvrir autant de fois qu’on veut sans rien changer. En réalité, elle ressemble plutôt à un fichier Word : à chaque ouverture, le cerveau doit « sauvegarder » à nouveau son contenu, sinon il risque de disparaître. C’est tout l’enjeu du processus de reconsolidation.
A l’époque, il était encore difficile de savoir si ces résultats pouvaient être observables chez l’humain, ce sera l’objet d’une prochaine étude que je vous présenterai!