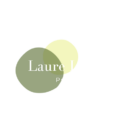La peur est une réponse émotionnelle indispensable à la survie, mais elle peut devenir problématique lorsqu’elle persiste ou réapparaît après un traumatisme. Des travaux publiés dans les années 2000 ont montré que la mémoire de peur n’est pas indélébile : lorsqu’elle est réactivée, elle redevient provisoirement labile et dépendante d’une nouvelle synthèse protéique pour se reconsolider dans un état similaire.
Pendant cette phase de reconsolidation, la mémoire est susceptible d’être modifiée..
Chez l’animal, plusieurs études ont montré que l’administration de propranolol — un bêta-bloquant — juste après la réactivation d’un souvenir de peur réduisait durablement la réponse de peur, suggérant une perturbation de la reconsolidation.
Cette action s’expliquerait par le blocage des récepteurs β-adrénergiques dans l’amygdale, normalement activés par la noradrénaline lors du stress, et impliqués dans la consolidation des souvenirs émotionnels.
Ces découvertes ont conduit Merel Kindt et ses collègues (2009) à tester, pour la première fois, si ce mécanisme pouvait être observé chez l’humain.
Protocole expérimental
- => Jour 1. Acquisition la peur
Tous participants ont appris à associer une image (CS1+) à un choc électrique léger, créant une réponse conditionnée de peur, lorsque l’image est présentée seule.
Dans une première condition contrôle, une autre image n’est jamais suivie d’un choc électrique (CS2-).
Cette peur a été mesurée :
Physiologiquement : Réflexe de sursaut oculaire amplifié. (voir encart plus bas)
Subjectivement : Les participants estiment la probabilité de recevoir un choc après chaque image.
=> Jour 2. Rappel et administration de propanolol
Le lendemain, la mémoire a été brièvement réactivée par la présentation unique de l’image, suivie de l’administration en double aveugle :
de propranolol
d’un placebo
- Extinction : les images sont présentées sans choc
- Récupération de la réponse : Le choc est délivré seul à trois reprises avant une nouvelle phase d’extinction
Le réflexe de sursaut oculaire amplifié : un biomarqueur solide de la peur
Le réflexe de sursaut oculaire est un réflexe involontaire rapide de clignement des yeux déclenché par un stimulus soudain et intense, en l’occurence dans cette étude, un bruit fort. Il est utilisé depuis longtemps en neuroscience et en psychologie pour mesurer la réactivité émotionnelle, notamment la peur.
En présence d’une menace perçue, le réflexe de sursaut peut être amplifié :
Plus grande amplitude du clignement
Réaction plus rapide
Cette modulation est principalement médiatisée par l’amygdale, région clé dans le traitement de la peur :
Ainsi, la force et la latence du sursaut oculaire sont des indicateurs fiables de l’intensité émotionnelle ressentie, même si la personne ne peut pas l’exprimer verbalement.
Dans ce cas précis, Des réponses de sursaut plus fortes face à un bruit fort en présence de l’image associée au choc (CS1+) par rapport à l’image non associée au choc (CS2-) reflètent l’état de stress du participant provoqué par la présentation de l’image CS1+

Résultats
1. Suppression de la réponse physiologique de peur
Le groupe “réactivation + propranolol” montre une disparition de la partie du réflexe de sursaut conditionné lié à la présentation du CS1+, indiquant une suppression de la réponse émotionnelle de peur. En effet, le niveau de la réponse lors de la phase extinction tombe au même niveau que pour la présentation du stimulus CS2-
2. Importance du rappel préalable
Sans présentation préalable de l’image (donc sans réactivation), le propranolol n’a aucun effet, confirmant que la mémoire doit être réactivée préalablement pour être modifiée.
3. Absence de retour de la peur
Après réexposition au choc seul :
Dans le groupe placebo, la peur réapparaît à un niveau élevé. C’est ce qu’on observe traditionnellement dans l’effet de « reinstatement » connu comme effet des procédures d’extinction.
Dans le groupe propranolol + réactivation, la peur ne revient pas.
Ce résultat montre que l’effet du propranolol est différent du simple processus d’extinction : la trace émotionnelle semble véritablement altérée.
4. Préservation de la mémoire de la contingence
Malgré la disparition de la réponse émotionnelle, les participants se souviennent que l’image peut être suivie d’un choc.
Autrement dit, la mémoire de la contingence (image → choc) est préservée, mais la composante émotionnelle réflexe a disparu.
Implications et perspectives
Cette étude constitue une des première démonstration chez l’humain qu’il est possible d’intervenir sur la reconsolidation pour agir sur une mémoire de peur.
Les résultats indiquent que :
Les récepteurs β-adrénergiques de l’amygdale sont essentiels à la reconsolidation de la peur.
Le blocage β-adrénergique pendant cette phase semble plus efficace que l’extinction traditionnelle pour prévenir la réapparition de la peur.
Ces observations a ouvert des perspectives thérapeutiques prometteuses, notamment pour le trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou les phobies, où la peur peut réémerger même après un traitement réussi. La thérapie de reconsolidation développée par le professeur Alain Brunet pour traiter le stress post-traumatique repose précisément sur cet effet.
Pourquoi j'ai choisi de présenter cette étude?
Bien que quelques études aient déjà été publiées à cette époque au sujet de l’effet du propanolol sur le traitement du stress post traumatique, il s’agit à ma connaissance de la première étude testant cette hypothèse en contrôlant l’ensemble des paramètres liés à l’acquisition de la réponse de peur. Cela rend la démonstration particulièrement solide sur un plan expérimental.
Par ailleurs, l’évaluation conjointe d’une réponse physiologique réflexe et d’une réponse déclarative permet de mettre en lumière que différents types de mémoires semblent se créer lors d’un conditionnement de peur. Cela soulève des questionnements au sujet du traitement thérapeutique des réponses émotionnelles de peur. Que se passe t-il si on supprime la réponse physiologique de peur sans altérer la mémoire sémantique associée? On peut imaginer, en dehors du laboratoire, que des prédictions verbales maintenues sur l’apparition d’un danger dans telle ou telle situation puisse à elles seules maintenir une forme d’anxiété. Est-il possible également d’altérer par un processus de reconsolidation ces mémoires verbales?
Pour finir, d’autres études ont depuis exploré l’effet du propranolol et d’autres interventions pharmacologiques sur la peur et le stress post-traumatique, mais cette étude reste une démonstration expérimentale particulièrement solide. Elle pose également la question d’investiguer l’efficacité de protocoles non médicamenteux, qui pourraient viser à moduler la mémoire de peur par la reconsolidation de manière ciblée et durable.
Référence : Kindt, M., Soeter, M., & Vervliet, B. (2009). Beyond extinction: erasing human fear responses and preventing the return of fear. Nature Neuroscience, 12(3), 256–258.